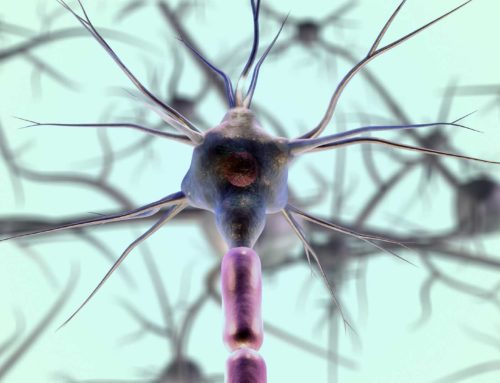La constance des utopies digitales
Dans cet épisode, nous allons vous conter l’histoire récente de l’informatique de gestion pour tenter d’en tirer quelques enseignements contemporains.
Ça y est ! C’est encore le vieux qui radote et qui va nous expliquer qu’avant c’était mieux et tout le trala la ! Garde tes histoires Papy Mougeot, le train du digital est bien lancé et toi tu es resté sur le quai.
Sauf que n’en déplaise à certains et certaines, il y a parfois quelques causes qui ont les mêmes effets, et les mêmes trains, même s’ils vont plus vite, vont parfois inexorablement dans les mêmes murs !
C’est paradoxal de se dire que c’est en regardant derrière nous qu’on voit mieux où l’on va, sauf à marcher à reculons, mais allons-y !
Jetons un œil sur l’histoire informatique récente pour éviter que certains de ses écueils ne se répètent. La constance des utopies digitales, c’est quoi l’histoire ?
Les années 90, c’est 3 courants digitaux et chacun d’entre eux portent une grosse promesse de bénéfices organisationnels et managériaux : les ERP, le Knowledge Management et l’essor d’Internet dans les entreprises.
Les ERP c’étaient (et c’est encore) une promesse amélioration de la productivité grâce à une modélisation des processus métiers et aussi une plus grande collaboration, chacun utilisant les mêmes substrats, le même socle, les mêmes logiques.
Or, on sait les complexités et les errances qui en ont résulté et on les observe toujours aujourd’hui : des projets pharaoniques aux bénéfices aléatoires mais aux surcoûts et dépassements de délais quasi systématiques et aux effets collatéraux de recloisonnement.
Dans le même temps, l’évolution technique de l’époque, notamment avec la baisse du coût du stockage a permis les premiers développements du Knowledge Management avec deux grandes caractéristiques.
D’une part, un sujet beaucoup plus guidé par les avancées technologiques que par les besoins humains. Et, d’autre part, une promesse très exagérée quant aux bénéfices attendus, notamment sur les dimensions prospectives et stratégiques du KM.
La seconde partie des années 90, c’est l’essor d’Internet et des Intranets en grande partie grâce aux propriétés natives des architectures N-Tiers de l’époque qui, contrairement au traditionnel client-serveur, favorisaient un déploiement massif à moindre coût.
Et là, tout allait vite dans la démesure, notamment la bulle financière qui a accompagné tout ça. L’une des promesses sous-jacentes c’était encore celle d’une meilleure collaboration interne, grâce aux échanges et aux transactions que la techno permettait plus facilement.
Comme si le management des connaissances passait d’une logique centrée sur le stockage à une logique de flux fondés sur les contributions des acteurs. La grande promesse de l’intelligence collective.
Les travaux de Nonaka et Takeuchi à cette époque, avec leur fameuse spirale des connaissances, avaient bien montré l’importance de la place de la culture, des valeurs et des relations interindividuelles. Et pourtant, la croyance ou le culte de la rationalité technologique a fait l’impasse, consciemment ou non, sur la nécessaire étape de socialisation des savoirs.
Il faut peut-être avouer là que le minimum d’intention de partage que cela demande n’est pas nécessairement naturelle quand on t’a expliqué pendant des années que l’information c’est du pouvoir ! Or, la technologie, quelle qu’elle soit, ne comble pas le manque de cette intention.
Les années 2000, c’est l’essor des intranets et des solutions collaboratives avec le même type d’engouement. Deux courants marquants alors.
D’une part, la généralisation des applications informatiques dites collaboratives, avec des modèles d’exploitation externalisés, les prémices du SaaS d’aujourdhui, et d’autre part l’envolée massive des réseaux et media sociaux et le développement d’une pratique digitale plus rapide à l’extérieur de l’entreprise qu’en son sein.
Là encore, les mêmes croyances ont eu les mêmes effets.
D’un côté, l’entretien implicite d’une confusion entre la réalité (l’outil permet de collaborer) et l’utopie (le corps social l’utilise pour coopérer) et qui conduit à occulter ce qui fait toute la différence entre les deux, notamment l’adhésion à un projet auquel aucune technologie ne peut se substituer.
Et de l’autre, la conviction que la forme de collaboration qu’on pouvait observer sur les réseaux sociaux pouvait se reproduire en interne dans l’entreprise grâce au seul pouvoir des outils.
Jean Pralong a par exemple montré l’inverse par exemple dans une étude en mai 2017 : « l’erreur que font les entreprises est de penser que leurs collaborateurs reproduiront dans un réseau social d’entreprise les comportements observés sur les réseaux sociaux privés comme Facebook »
Là encore, le facteur humain que diable ! Tiens on continue, la crise de la covid : tout le monde confinés avec Teams, Slack et zoom et hop l’acculturation digitale est enfin faite de force. Une fois de plus, qu’avons-nous observé dans les pratiques ?
Que ce n’est pas parce que tu utilises Teams que tu as développé une culture d’un travail plus collaboratif. J’ai même envie de te dire que si tu n’as précisément pas envie de collaborer les outils t’offriront de multiples leviers pour te le permettre.
La vague de novation de l’IA, à voir l’engouement que suscite la puissance de ChatGPT, s’inscrit dans la même lignée : elle obéit aux mêmes promesses de transformations radicales avec la même négligence du facteur humain.
Elle pose même en plus des questions éthiques, des questions de libertés individuelles ou des questions socio-politiques. On nous annoncerait même une rupture technologique si forte qu’elle induirait l’hypothèse d’un saut anthropologique.
Deux invariants semblent ressortir à nos yeux de cette immersion dans un passé digital récent.
D’abord une croyance récurrente et exagérée que le digital est le moteur de la coopération en entreprise. Ce qui est évidemment utopique, voir naïf. Et ensuite, que l’efficacité digitale est clairement dépendante du facteur humain, à l’Homme avec toutes ses « hommeries ».
Gardons-nous donc d’être naïf et de croire aveuglément en la toute-puissance du digital, sans nier pour autant qu’il nous offre un bras armé extraordinairement puissant, à la condition que nous en admettions les limites pour mieux profiter réellement de ses bénéfices !
En résumé, un regard sur le digital en entreprise entre 1990 et 2020 montre que le facteur humain conditionne grandement son succès dans les résultats qu’on en attend et que, par conséquent, croire que la puissance du digital se suffit à elle-même est utopique quand bien même soit-elle fascinante.
J’ai bon chef ?
Oui tu as bon mais on ne va pas en faire toute une histoire.