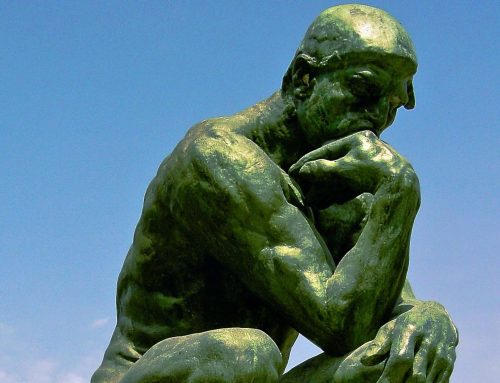De plus en plus nombreux et de moins en moins ensemble
Dans cet épisode nous allons parler du vivre ensemble dans la société et l’entreprise, ou peut-être aussi de son contraire : le repli sur soi.
Dans cet épisode nous allons parler du vivre ensemble dans la société et l’entreprise, ou peut-être aussi de son contraire : le repli sur soi.
Plus on est nombreux, plus il pourrait sembler difficile de vivre ensemble. À observer certaines dérives, on pourrait effectivement croire que notre monde n’a d’autre issue que de s’entredéchirer, un monde où ceux qui sont pour s’opposent à ceux qui sont contre et où ceux qui ne savent pas, parlent encore plus fort pour être entendus.
Mais le nombre n’est pas un facteur suffisant pour expliquer cette difficulté à vivre ensemble, loin s’en faut. Alors, c’est quoi l’histoire ?
Lorsque l’on observe nos sociétés occidentales, riches et confortables – et nous allons ici nous concentrer sur celles-ci – plusieurs caractéristiques éclairent ce sujet du « vivre ensemble » qui semble de plus en plus impossible.
La première caractéristique à souligner est celle de la quête hédoniste. C’est-à-dire le fait de considérer la recherche de plaisir, et l’évitement des souffrances, comme le but de l’existence humaine.
Et cette quête n’est pas nouvelle, puisque cette doctrine est apparue dès l’Antiquité, mais nos sociétés d’hyper-consommation de masse ont poussé cette quête à son paroxysme.
Or, notre niveau de confort étant déjà particulièrement élevé – en tout cas par rapport à d’autres – cette quête presque infinie de plaisir et bien-être personnel, est non seulement exagérée mais elle devient surtout de plus en plus difficile à assouvir.
Et cette difficulté est renforcée par un deuxième phénomène : les hyper-crises mondiales qui se succèdent.
Nous n’allons pas toutes vous les citer : les attentats de 2001 qui marquent un monde qui bascule, la crise financière de 2008 qui signe un changement de rapport de forces macro-économiques au détriment de l’occident, jusqu’à la crise sanitaire de 2020 qui nous renvoie à nos fragilités et nos interdépendances.
Si toutes ces crises sont de natures différentes, elles contribuent à ce que nous prenions conscience – par la force des choses – des limites que le monde et sa réalité souvent brutale mettent à cette quête d’épanouissement de soi. Une prise de conscience qui est d’ailleurs renforcée par notre compréhension plus ou moins grande (d’ailleurs) des limites des ressources naturelles. C’est peut-être ce qui conduit certain×es à vouloir se gaver avant qu’il ne soit trop tard.
On a donc ici tous les ingrédients du cocktail : une quête ultime de l’épanouissement de soi qui se brise sur le mur du réel. Elle entraine alors un repli sur soi. C’est ce que Gilles Lipovetsky soulignait lorsqu’il décrivait le passage de la post-modernité à ce qu’il qualifiait d’hypermodernité. Un désir dont on prend conscience qu’il est impossible de le satisfaire, donc une frustration plus un repli sur soi et une sorte d’hypersensibilité à tout ce qui pourrait contrarier…
Et si on ajoute à ce cocktail explosif, quelques éléments que l’on n’a pas encore cité comme les réseaux sociaux qui servent à merveille le culte de l’égo, certains médias qui agitent les peurs parce que le papier ne refuse pas l’encre, sans parler des attitudes de certains acteurs politiques … alors les ferments du rejet l’Autre ne sont pas bien loin.
Et bien sûr, la vie de l’entreprise n’échappe pas à tout cela. Les salariés sont avant tout des citoyens. Les traductions de ces traits sociétaux dans l’entreprise sont donc légions et ont notamment pris la forme d’un·e salarié·e dont on essaye de choyer le bien-être qu’il·elle exige coûte que coûte. Menant certain à considérer que le bien-être au travail est un dû, conduisant ainsi à une prolifération opportuniste du courant du bonheur au travail ou de l’épanouissement personnel.
Certaines démarches de QVT ressemblent alors à des cautères sur des jambes de bois à force de préoccupations centrées sur ce bien-être et sur ce qui entoure le travail plutôt que sur le travail en lui-même, alors que, dans le même temps, la brutalité, voire la vacuité, du travail en tant que tel ne cesse de sauter aux yeux mais semble reléguer au second plan. Mais c’est un autre sujet.
En substance, quand on prône la singularité de l’individu et qu’on nourrit – peut-être maladroitement ou avec de sincères mais naïves bonnes intentions – un « moi » déjà hypertrophié, il ne faut pas s’étonner de voir le vivre ensemble se déliter.
Entre le « Je » et le « Nous », entre un nécessaire besoin d’identité et un non moins nécessaire besoin d’appartenance, l’excès de l’un nuit toujours à l’autre. En définitive, ce que nous devons individuellement et collectivement comprendre, plutôt que de nous replier puis nous assécher sur nous-mêmes, c’est simplement que plus on est nombreux plus nous devons plus que jamais apprendre à vivre ensemble !
Absolument, et en entreprise, apprendre – ou réapprendre – à vivre ensemble impose deux conditions : d’une part, se respecter les uns les autres car c’est la condition minimale de la coexistence de personnes qui forment société. Mais c’est un autre sujet.
Et d’autre part, respecter ce qui réunit ce groupe de personnes – en l’occurrence l’entreprise – car c’est précisément la raison pour laquelle elles doivent « vivre ensemble ». Et c’est aussi un autre sujet.
En résumé, la question du vivre ensemble en entreprise se pose sur un terreau sociétal qui lui est peu favorable : un désir infini de bien être qui se heurte aux limites du réel et qui conduit à des frustrations, un repli sur soi et donc un rejet de l’autre qui rend ce vivre ensemble de plus en plus difficile. Il faut donc réapprendre à vivre ensemble et en entreprise cela pose 2 exigences 1. Le respect de l’autre car c’est la condition minimale de la coexistence et 2. Le respect de ce qui unit, à savoir l’entreprise.
J’ai bon cheffe ?
Oui tu as bon mais on ne va pas en faire toute une histoire